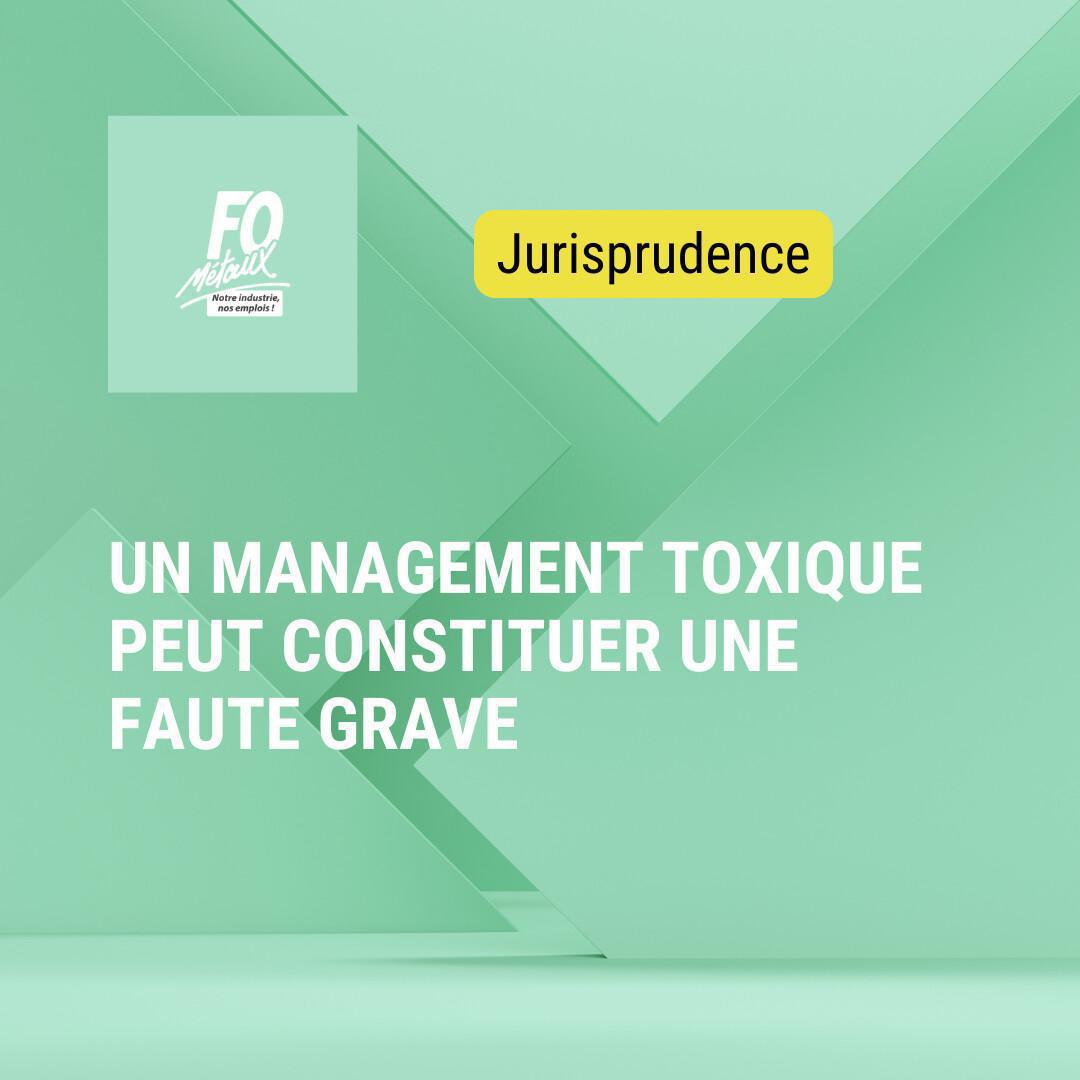Dans un arrêt rendu le 6 mai 2025 (n°23-14.492), la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît qu’un comportement managérial autoritaire, rigide et dévalorisant peut, à lui seul, justifier un licenciement pour faute grave, dès lors qu’il génère une souffrance avérée dans l’équipe.
Les faits
Un salarié, recruté en tant que responsable d’édition, avait reçu un avertissement pour des méthodes de gestion particulièrement rigides. Malgré cet antécédent, les remontées négatives se sont poursuivies, jusqu’à alerter le médecin du travail, qui évoque une souffrance collective dans l’équipe. L’employeur engage alors une procédure de licenciement pour faute grave.
La cour d’appel avait annulé ce licenciement, estimant que l’absence d’enquête interne ou de nouvelle sanction disciplinaire de la part de l’employeur relativisait la gravité des faits reprochés. La Cour de cassation censure cette lecture.
La position de la Cour de cassation
La haute juridiction rappelle que l’appréciation de la faute grave s’effectue au regard des seuls agissements du salarié, indépendamment :
- de l’existence ou non d’une enquête interne,
- de la réactivité de l’employeur,
- ou du comportement de tiers.
Elle précise qu’un management dévalorisant, rigide et autoritaire, même sans violences verbales ni harcèlement caractérisé, peut suffire à rompre immédiatement le lien de confiance, dès lors que les effets sur la santé des collaborateurs sont établis.
Une évolution notable
Cet arrêt marque un tournant dans la reconnaissance juridique des formes insidieuses de souffrance au travail. Il élargit le champ des comportements fautifs à des pratiques managériales qui, bien que parfois banalisées, produisent des effets délétères documentés.
Trois apports principaux :
- Le style de management devient un objet d’analyse juridique : les effets du comportement sur la santé mentale des équipes sont désormais un critère d’évaluation disciplinaire.
- L’inaction de l’employeur n’efface pas la faute : la responsabilité du salarié subsiste même si l’entreprise tarde à réagir.
- La parole du médecin du travail prend un poids probatoire important : son signalement a été central dans la caractérisation de la gravité des faits.
Par cet arrêt, la Cour de cassation élargit la notion de faute grave à des comportements managériaux nocifs, même en l’absence de violences manifestes. La santé mentale au travail devient un critère décisif de licéité du comportement hiérarchique.
Ce qu’il faut retenir :
« que le manquement de l'employeur à ses obligations, notamment de sécurité et de formation, ne dispense pas le salarié de ses propres obligations en la matière ; que commet une faute grave le salarié qui occupe une position hiérarchique importante et persiste dans un comportement caractéristique de harcèlement moral envers les salariés sous sa subordination »
Ainsi, la responsabilité individuelle est engagée et ce, indépendamment du contexte.
Un signal clair pour toutes les entreprises :
- Le style de management est désormais jugé à l’aune de ses conséquences sur la santé mentale des équipes.
- L’inaction de la hiérarchie ne protège plus un salarié usant d’un management toxique.
- Le médecin du travail devient un lanceur d’alerte clé dans ce type de dossiers.
Cet arrêt confirme une tendance : la souffrance au travail devient un critère juridique. Et ça, FO métaux ne peut qu’acquiescer.